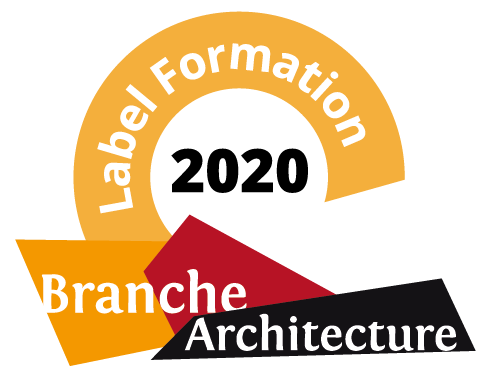La formation de l’architecte diplômé d’État à l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP), porte spécifiquement sur l’exercice de la maîtrise d’œuvre et sur les responsabilités et compétences professionnelles qui s’y rattachent. Elle comprend une formation théorique de 150 h minimum et une mise en situation professionnelle de six mois minimum.
La formation théorique
Session 1 : Acteurs et processus
encadrée par Jean Philip LEBECQ, architecte, Maître de conférences associé.
Cette première session aborde la maîtrise d’oeuvre à partir du postulat que toute construction est une épreuve, toujours renouvelée. L’architecte, maître d’oeuvre, est confronté à divers acteurs, pas toujours les mêmes, et ceci tout au long de la durée du projet.
- Qui sont ces acteurs ?
- Quel rôle le maître d’oeuvre lui-même a-t-il à jouer dans le projet ?
- Un projet se déroule sur plusieurs années : pas moins de cinq ans sont souvent nécessaires à sa réalisation, parfois bien davantage.
Comment les choses se déroulent-elles, et dans quel ordre ? - Quelles sont les phases dans lesquelles chacun s’implique, à commencer par le maître d’oeuvre lui-même ?
Évolution de la commande et nouveaux cadres de conception
Nous assistons actuellement à des mutations profondes de la profession. Apparition de nouvelles formes de contrat, bouleversements dans les phases et les temps qui leurs sont consacrés.
- Quelles conséquences sur l’architecture bâtie ?
- Quelle attitude avoir par rapport à ces nouvelles formes que prend le processus de conception ?
A travers les expériences et les questions des ADE, cette session qui doit être avant tout un débat contradictoire, tentera d’aborder ces questions, éventuellement d’apporter quelques réponses, d’affirmer des positionnements. Des intervenants variés, architectes mais aussi maîtres
d’ouvrage, bureaux d’étude nous accompagneront pendant ces trois jours pour donner leurs points de vue.
Session 2 : L'entreprise d'architecture
Gestion d’agence, contrats de travail, l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Session 3 : Passage
Bilan intermédiaire
Session 4 : Le chantier, horizon pratique
La quatrième session est dédiée au monde du chantier dans tout ce que définit un horizon pratique selon Pierre Bernard. Le chantier comme un évènement long qui convoque une dimension sociale, technique et créative tout en rassemblant de multiples intervenants autour d’un objectif commun, construire.
La session aborde le chantier à partir d’études de cas mettant en évidence la conception sur le terrain, l’inventivité des outils et des moyens, la dimension sociale intrinsèque et les enjeuxenvironnementaux liés aux changements climatiques devenus partie prenante du process.
L’engagement de l’architecte dans cette phase du chantier est encouragée et motivée à partir de modèles historiques servant d’introduction à la session.
Les paroles sont croisées à travers la participation d’intervenants extérieurs : bureau d’étude, conducteur travaux, chef de chantier, compagnons.
Des visites sont organisées, chantier en cours et usine de production de matériaux, dans le butde soulever des problématiques in situ et permettre aux ADE de s’interroger sur la vie du chantier, les modes constructifs et les modes de production.
L’objectif est double, répondre aux attentes des ADE concernant la place de l’architecte sur le chantier (rôle de la maîtrise d’oeuvre, responsabilités, outils, moyens) et sensibiliser les ADE aux enjeux de cette phase dans la mise en oeuvre de la qualité architecturale de l’édifice.
En parallèle, il s’agit d’ouvrir les champs de questionnement et de compréhension pourencourager la réflexion portée par l’écriture du mémoire de HMONP.
Session 5 : La norme et ses entours / Voies de progrés
architectes / ingénierie / entreprises, atex, innovations,…
Face à un cadre réglementaire que l’on pourrait décrire ou subir telle « une sphère étouffante, constituée de normes, labels, règlements », nous nous attacherons ici à interroger les moyens dont dispose l’architecte pour développer une attitude prospective, au bénéfice du projet architectural.
Ces questionnements s’inscrivent naturellement dans le cadre et la réalité du changement climatique.
Nous questionnerons ce qui semble aujourd’hui constituer des réponses possibles à cette situation contemporaine pour l’approfondir, en mesurer les limites et la mettre en critique.
-Comment se positionner dans ce cadre réglementaire ?
-Comment s’emparer de l’évolution du cadre réglementaire, de notre culture, de nos habitudes, pour aborder cette situation de façon prospective ?
L’enjeu de cette session consiste donc à interroger le cadre de la production architecturale, qu’il soit réglementaire, normatif, qu’il réponde simplement à la norme entendue comme culture, habitude.
L’interroger pour comprendre les différents ressorts de cette « normalisation » et envisager les conditions de l’expérimentation, en profitant notamment d’une période de transition, propice à l’expérimentation, ou, à tout le moins à la transformation des manières de construire.
L’ADE est amené à comprendre les leviers sur lesquels il peut agir : à quel moment des études et de la construction agir, quels sont les interlocuteurs à interpeller, etc. ?
Cette session sera délibérément hétérogène, tant par les thèmes abordés que par les temps du projet convoqués, afin d’envisager la diversité des actions que peut entreprendre l’architecte pour interroger les normes, s’affranchir des standards, alimenter les recherches et faire évoluer la conception et la construction de notre cadre de vie, en lien et au profit des enjeux sociétaux contemporains.
Il s’agit donc de montrer sans exhaustivité des voies possibles d’expérimentation et de progrès. Les éclairages proposés pourront donc être abordés de façon autonome, sans autre articulation entre eux que cette démarche prospective à laquelle nous allons nous attacher.
Session 6 : Métiers/profession/société
Encadrée par Antoine BEAL, architecte, m.a. TPCAU.
L’idée est de déjouer dans cette session l’opinion commune et ressassée par les ADE pensant « défendre » leur projet contre les autres plutôt que le transformer, l’enrichir, lui faire prendre du sens dans le réel sans lequel il n’y a pas d’architecture.
Les intervenants
Chaque enseignant titulaire, responsable de session, aura la charge de composer les cours et les participations d’autres enseignants de l’école comme de professionnels non enseignants, choisis avec l’accord de l’école, pour leurs compétences professionnelle et leur intégrité. Les responsables de session s’assurent du contenu et du mode d’expression des intervenants et prévoient la logistique qui leur est nécessaire. Dans tous les cas, ces responsables :
- assistent à leurs exposés et prennent la parole pour les cadrer dans l’ensemble de la formation, et le cas échéant les commenter et compléter ;
- s’assurent que le dialogue sera possible avec les participants architectes diplômés d’Etat ;
- recadrent et complètent les questions des participants ;
- récapitulent en fin d’exposé.
Liste indicative d’intervenants extérieurs :
Architectes
- institutions : CROA, Syndicats d’architectes,
- enseignants praticiens de l’ENSAPL ou d’autres écoles associées,
- architectes praticiens non enseignants choisis par l’école pour une opération ou pour la qualité de leur œuvre, leur expertise dans un domaine concerné par la HMONP,
- architectes-experts près les tribunaux.
Animateur ou modérateur de débats
- journalistes de presse traditionnelle,
- journalistes de presse spécialisée.
Maîtres d’ouvrage
- institutionnels, clubs de maîtres d’ouvrage,
- privés ou publics, propres à chaque opération ou sur sujets spécifiques.
Utilisateurs
- institutionnels, syndicats du cadre de vie, société de consommateurs,
- utilisateurs propres à chaque opération ou question examinée.
Partenaires de l’ingénierie et de la maîtrise d'oeuvre
- institutionnels
- ingénieurs conseils, BET, BET spécialisés, économistes, propres à chaque opération.
Juridique
- juristes du droit de la construction
- juristes du droit des affaires, des prud’hommes,
- juristes des conflits entre professionnels, juges des chambres ordinales.
Pathologies
- experts près les tribunaux,
- juges des chambres de construction,
- mutuelle des architectes, experts de la MAF
- assureurs, experts d’assureurs, experts d’assurés,
- avocats spécialisés en affaires de construction.
Entreprises
- institutionnels, fédérations
- bureaux et sociétés de méthodes, BET d’entreprises propres à chaque opération ou question examinée.
Industriels
- institutionnels, fédérations, groupements,
- propres à chaque opération ou question examinée,
- propres aux matériaux objet des études de cas Travail personnel demandé aux participants.