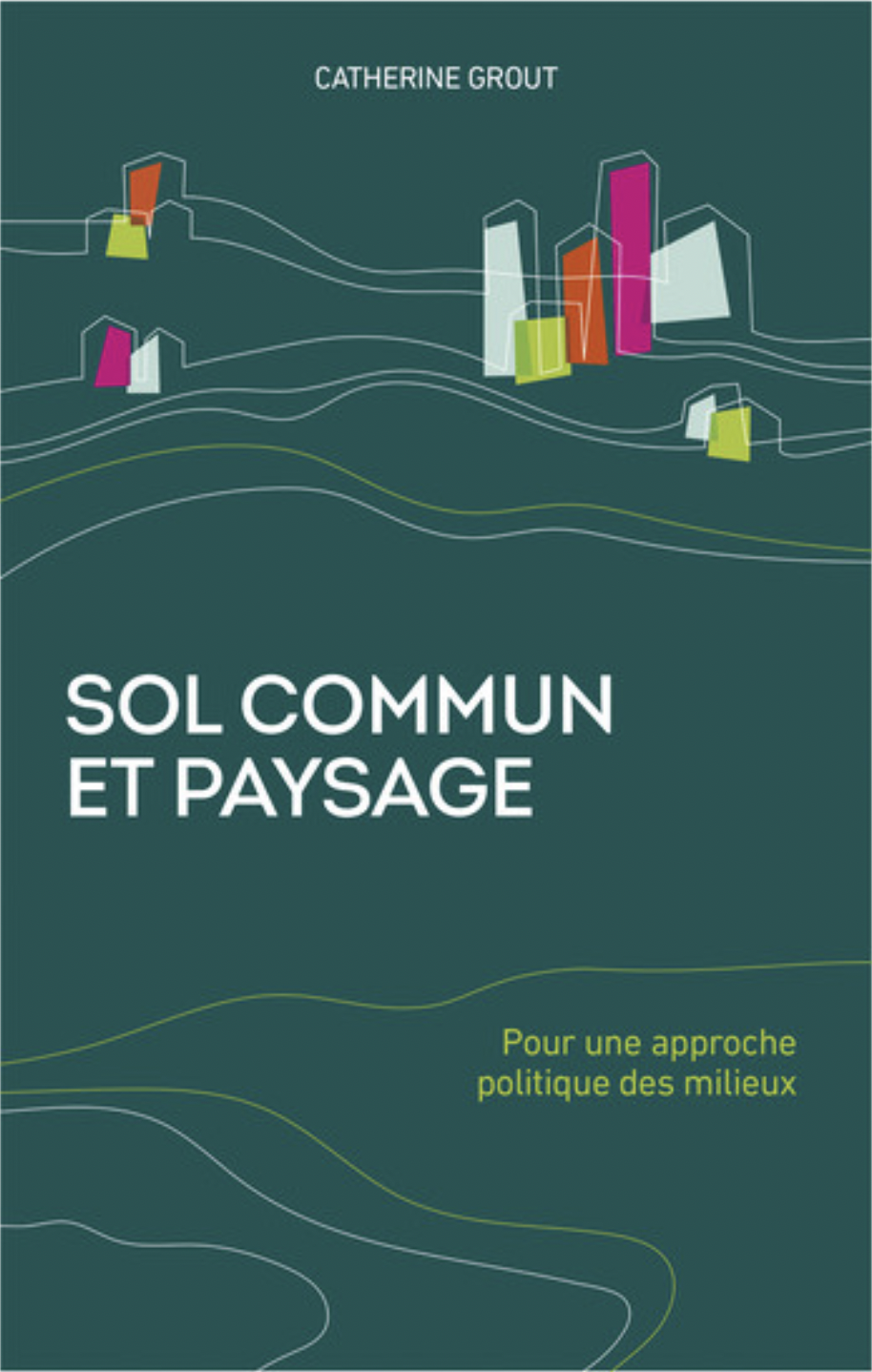Sol commun et paysage.
Pour une expérience politique des milieux.
INTRODUCTION
La réflexion sur la notion de sol commun est venue de l’ambition de poursuivre un questionnement politique avec le paysage et à son sujet. Si d’une part, celui-ci est polysémique, – ainsi différentes disciplines en sciences et en sciences humaines le définissent à leur manière –, d’autre part, il serait encore souvent dissocié du politique – mais pas des politiques publiques –, rangé du côté d’une construction sociale et culturelle ou bien de l’art avec une appréciation encore principalement visuelle, même si elle est plus fréquemment associée maintenant à une perception polysensorielle. Cette réflexion fait suite à des études ayant traité du paysage et de sa représentation en tant que pratique culturelle d’appropriation territoriale (Baker et Biger, 1992, Mitchell, 1994, Bender 2001, Olwig 2002) ou de fixation d’une image identitaire (Cosgrove, 1993, Conan, 1994, Chenet et al., 1999, Walter, 2004). Corrélativement, fondant la problématique à partir de l’expérience située (Dastur, 2001) ce questionnement politique associe une considération de l’aliénation du monde (Arendt, 1993) et d’un changement de paradigme qui concerne le paysage et le sujet. Ainsi, pour le philosophe japonais Kobayashi Yasuo1, « à travers le paysage, on commence à sentir l’univers non plus par l’“ externe” mais l’“ interne”, c’est pourquoi l’expérience nous permettrait de changer enfin de paradigme en quittant le modèle du monde physique [l’espace géométrique] pour celui du monde biologique et écologique » (Kobayashi, 1998, p. 138), c’est- à‑dire pour le monde environnant en lequel l’être humain ne serait ni la figure centrale décidant de tout et désirant tout maîtriser et contrôler ni en distance. Ce changement de paradigme, tel qu’il l’énonce et qui correspond à un mode d’être et de relation porté par une présence au monde, correspondrait aux enjeux environnementaux, sociaux, culturels et politiques actuels, car il concerne aussi bien des attitudes (manière de penser par exemple un projet de paysage), des intentions (à quoi et pour qui un projet est-il destiné ?) que des modes de faire (comment projeter ? comment envisager ses actions ?) et de se penser avec le monde environnant (de quel monde s’agit- il ?). […]
Professeure d’esthétique HdR à l’Ensap de Lille et chercheuse en esthétique au Lacth, ancienne résidente de la Villa Kujoyama, Catherine Grout codirige une recherche sur l’hôpital comme milieu. Elle est codirectrice scientifique du réseau thématique scientifique Japarchi et membre du comité de rédaction de la revue Projets de paysage.
Informations
- Éditions des PUG, collection « Territoires, Aménagements, Architectures, T2A
> Consulter le lien de l’éditeur